-
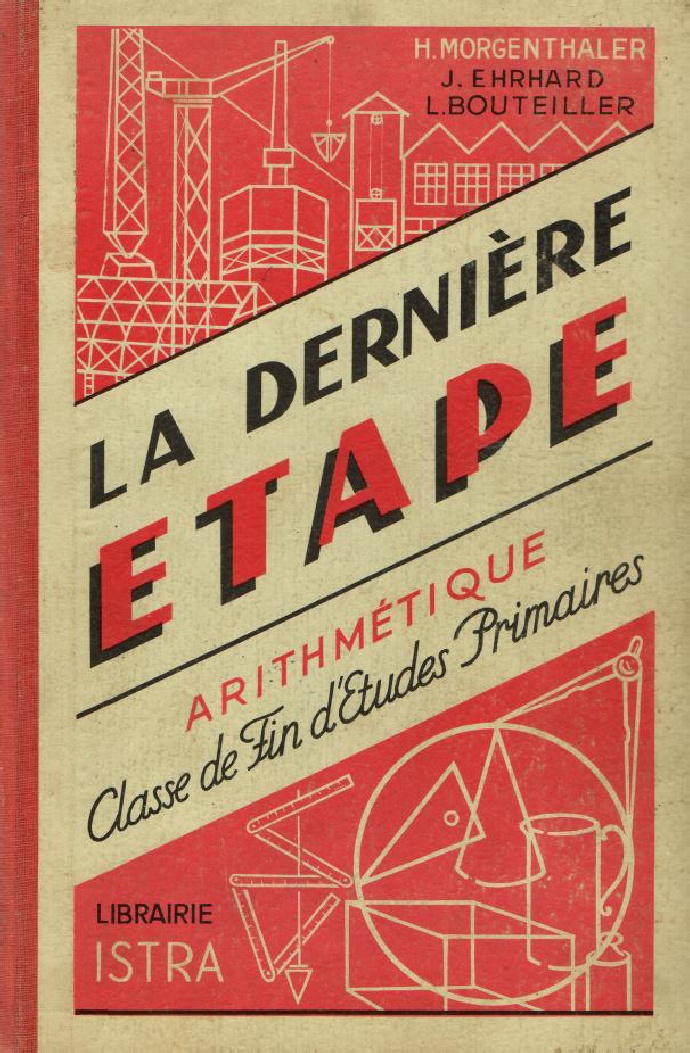.jpg)
1957 : un bon cru pour l'accès aux études secondaires
C’est une affaire entendue par tous : l’école d’autrefois était sélective et élitiste ! Une infime minorité d’élèves faisaient des études supérieures, très peu avaient le bac, et peu fréquentaient le secondaire. Avant la "massification" et le collège unique (1975), point de salut scolaire pour l'enfant d'ouvrier ou de paysan.
Pourtant, en 2004 déjà, Michel Delord a contredit définitivement ceux qui prétendaient de manière fallacieuse que seulement 10% d’une classe d’âge était admise en 6e dans les années 601. Il a montré la réalité du « mouvement de démocratisation » qui eut lieu depuis l’immédiate après-guerre jusqu’aux réformes Fouchet de 1963, portant 55% des élèves en 6e à la rentrée de 1962. EN 1992, Antoine Prost lui-même, pourtant à l'origine, avec d'autres, des réformes scolaires des années 70, admettait (en 1992, dans Education, société et politique) :
La démocratisation est en marche. C’est précisément le moment où intervient la réforme des collèges. Ni les experts gouvernementaux, ni les sociologues, ni les syndicats enseignants ne percevaient qu’une démocratisation effective était en train de se produire.
On dira que 55%, c’est peu, et que le taux de fréquentation de la classe de 6e n’est pas un critère bien ambitieux pour juger du caractère plus ou moins démocratique d’un système scolaire. C’est oublier qu’après la 6e, il y a la 5e, la 4e, etc., et que les taux de passage et de réussite du BEPC augmentent régulièrement au cours de la période.
C’est oublier surtout que si le taux d’entrée en 6e est un indice qui montre effectivement les limites de la démocratisation en termes d’accès aux cycles secondaire puis supérieur, il est passablement déficient quand il s’agit de rendre compte du niveau d’instruction global des élèves. En effet, il faudrait pour que ce soit le cas que les 55% d’entrée en sixième de l’année scolaire 1962-1963 correspondent exactement au nombre d’élèves capables d’entrer en 6e. Aujourd'hui, tous les élèves entrent au collège depuis 1975 et la loi Haby sur le « collège unique ». 100% des élèves capables d’aller au collège y vont. En étant un peu polémique, on ajouterait qu’il n’y a pas 100% d’élèves de niveau collège qui sont au collège.
Les oubliés statistiques du taux d'entrée en 6e : les "capables" non intégrés
Or, une étude a été menée en 19572, année de la suppression de l’examen d’entrée en 6e (sauf pour les élèves des écoles privées et ceux qui n’atteignaient pas la moyenne en CM2) : elle a mesuré le taux d’élèves qui avaient le niveau pour entrer en 6e et qui pourtant n’y entraient pas. D’après cette étude, 23% des 4860 élèves de l’échantillon, pris dans 397 écoles, auraient pu entrer en 6e et ne l’ont pas fait. Extrapolant grossièrement à partir de ce taux de 23% de « capables » non intégrés, l’auteur évalue à plus de 100 000 les CM2 de 1957 qui sont passés à côté de cet accès au secondaire.
L’ordre de grandeur est le bon, mais les chiffres sont encore plus impressionnants si on refait quelques calculs. Si on compte nous aussi 23% des « environ 600 000 élèves de CM2 » en 1957, cela ne fait pas 100 000 mais bien 138 000 élèves. Il y a donc non pas « plus de 100 000 » « capables » non intégrés, mais bien un peu moins de 150 000. Il faut certes mesurer le caractère approximatif de ces calculs, mais ils sont, me semble-t-il, assez frappants.
Toutefois, le plus parlant est d’additionner le taux d’élèves effectivement entrés en 6e à la rentrée de 1958 avec le taux d’élèves capables qui n’y sont pas entrés, calculé entre avril et mai 1957. Cette année-là, première année sans examen d’entrée, il y avait 45% d’élèves en 6e. On peut donc calculer que 68% des élèves qui n’avaient pas redoublé leur CM2 avaient le niveau pour entrer en 6e. L’ordre de grandeur est donc de plus des deux tiers !
La démocratisation des années 50 : le rattrapage de la puissance d'instruction de l'école primaire
Ce chiffre assez important permet de contredire ceux qui considèrent que la massification est intervenue avec l’augmentation de l’âge de scolarisation obligatoire à 16 ans, intervenue un an après, en 1959. Comme le disent Guy Morel et Michel Delord, il y a « une progression régulière et une démocratisation notable de l’accès au secondaire de la fin de la guerre aux années soixante. »3 Plus encore, cette progression et cette démocratisation n’épuisent pas le vivier d’élèves au niveau du secondaire. En cela, on peut affirmer que l’aptitude de l’école communale de l’après-guerre à instruire tous les élèves était supérieure à la capacité du système scolaire et de la société dans son ensemble à leur faire continuer leurs études.
L’école était en quelque sorte plus « démocratique » que la société et la période courant de 1945 à 1959 ne fut en quelque sorte que le rattrapage, par le secondaire et le Cours Complémentaire (devenu CEG en 1959), de la puissance d’instruction du primaire élémentaire. Les causes de cette démocratisation sont donc très différentes de la démocratisation du bac, survenue par la suite, qui fut le fruit de la création des bacs professionnels, combinée à une baisse d’exigence dans les corrections.
Les classes de fin d'étude : du temps pour rattraper le niveau
Mais ces deux-tiers d’élèves au niveau de la 6e doivent être encore pondérés par la proportion d’élèves qui, à 11 ans, n’avaient pas le niveau pour entrer en 6e, mais restaient en Classe de fin d’études primaires jusqu’à 14 ans pour y tenter de décrocher le Certificat d’études primaire. Tous ne l’obtenaient pas, et il faut supposer que la plupart des diplômes de « Certif’ » était obtenu par les fameux 23% d’élèves de niveau 6e. Mais il est aussi possible que tous les élèves qui n’ont pas tenté d’entrer en 6e, alors qu’ils le pouvaient, n’ont pas non plus tenté le diplôme du CEP.
En outre, d’après les chiffres postés par Pedro Cordoba4, 31,2% des filles et 22,3% des garçons nés entre 1937 et 1946 obtenaient le certificat d’étude. Si l’on considère que les élèves de Cours complémentaires et de 6e passant et obtenant ce diplôme constituaient l’exception, et non la règle (puisque le brevet les attendait en fin de cycle), il faut bien se rendre compte que le taux de réussite au CEP en 1957 excédait les 23% de « capables » non intégrés. On peut donc imaginer une proportion supérieure au deux-tiers des élèves d'une classe d'âge ayant soit le niveau sixième, soit le niveau du Certificat de fin d'études.
Concrètement, en Classe de fin d’études se côtoyaient :
- les élèves qui auraient pu aller en 6e mais se contentaient d’obtenir le Certificat d’étude, pour la plus grande partie d’entre eux ;
- ceux qui n’avaient pas eu le niveau en temps voulu mais parvenaient tout de même à obtenir eux aussi le CEP,
- la grosse vingtaine de pourcents d’élèves qui n’obtenaient aucun diplôme5 (voir tableau de Pedro Cordoba), dans lesquels il faut compter les quelques pourcents de ceux qui auraient pu l’obtenir mais ne l’ont, encore une fois, pas passé.
Pour expliquer la capacité à réussir le certificat d’étude quelques années après avoir échoué à l’examen de 6e, ou bien ne pas l’avoir présenté à cause d’un niveau insuffisant, rappelons que bien souvent, la Classe de fin d’étude était couplée avec le Cours supérieur, classe destinée à préparer les futurs élèves des Cours complémentaires. Les manuels étaient bien souvent communs, ainsi que les programmes.
Bien sûr, il est très probable que certains élèves ne pouvaient suivre un tel rythme. Pour ceux-là, les classes post-élémentaires de l’école primaire servaient surtout à attendre 14 ans, âge légal de fin de scolarité depuis 1936. Mais pour les autres, c’était le moyen de suivre un enseignement de grande qualité, susceptible de leur faire acquérir les connaissances nécessaires à l’obtention du Certif’.
***
Deux observations pour finir.
Tout d'abord, il faudrait comparer le nombre des élèves de 1957 suffisamment instruits pour passer en 6e, ou obtenir le CEP dans la foulée, avec le nombre d'élèves actuels incapables de suivre correctement un cours de collège.
Ensuite, il est plaisant d'imaginer une grande enquête proposant aux élèves actuels les examens d'entrée en 6e et les épreuves du certificat d'étude de l'époque, dans des conditions permettant véritablement la comparaison cette fois6. Même après une année de bachotage qui aborderaient les programmes de CM2 de 1945, il n'est pas du tout sûr que plus des deux-tiers des élèves actuels réussissent.
1Michel Delord, « Note technique sur la 'massification' », 2004, URL : http://michel.delord.free.fr/massif.pdf2Alain Girard, « L'entrée en classe de sixième », Population, 13e année, n°4, 1958 pp. 687-688, URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-4663_1958_num_13_4_57403Michel Delord et Guy Morel, « Lire, écrire, compter. La pédagogie oubliée », 2006URL: http://www.slecc.fr/GRIP_buisson/01buisson-intro.pdf, p. 174Pedro Cordoba, « Faire l’économie des diplômes-3 : Monsieur Maurin bouleverse la science », 2013, URL : http://pedrocordoba.blog.lemonde.fr/2014/01/05/monsieur-maurin-bouleverse-la-science/5Pedro Cordoba, ibid.6Michel Delord, "Connaissances en français et en calcul des élèves des années 20 et d'aujourd'hui. Bilan partagé ?", 2003 , URL : http://michel.delord.free.fr/cep96.pdf 14 commentaires
14 commentaires
-
Version téléchargeable : Peut-on apprendre à lire sans entendre les consonnes ?
"... Voyelle. – Voyelle. – Voyelle. – Voyelle – Voyelle..."
Savez-vous que nous n'entendons pas les consonnes ?
En effet, pour certains, la critique de ce qu'ils appellent le B A-BA, c'est-à-dire dans leur esprit des méthodes synthétiques d'apprentissage de la lecture (de la lettre au mot), se justifie par l'impossibilité supposée pour l'oreille humaine, à plus forte raison pour l'oreille enfantine, d'entendre les consonnes.
C'est le cas de Rémi Brissiaud, un des grands spécialistes français de l'enseignement des mathématiques, qui a pris la relève du défunt André Ouzoulias dans le suivi et la promotion d'une expérimentation dans l'apprentissage de la lecture dans une ZEP des Mureaux. Selon lui :
[…] comment un enfant pourrait-il écrire son prénom ou une phrase [...], sans aucune maîtrise de la graphophonologie ? Pour créer cette possibilité, il faut évidemment que, dans un premier temps, l’enseignant « prête son savoir à l’élève » (Cf. Vygotski). Concernant l’écriture du prénom, par exemple, l’enfant dispose d’un modèle écrit ainsi que d’un « geste modèle » qui lui est commenté : « Tu vois, pour écrire ton prénom, il faut écrire la lettre M, comme ça (l’enseignant reproduit la 1ère lettre du modèle), puis la lettre A (idem), la lettre R (idem), la lettre I (idem) et la lettre O (idem) et toutes ces lettres, dans cet ordre, ça fait /ma/ (en montrant les 2 premières lettres, MA), /rio/ (en montrant les suivantes : RIO). Allez, vas-y, écris ton prénom ».
On remarquera que les lettres M et R sont appelées par leur nom : dans un premier temps, il n’y a aucune tentative de faire sonner une consonne qui, pour les élèves, ne sonne pas. Mais évidemment, l’intérêt des voyelles comme A, I et O, etc. est que leur nom correspond à une valeur phonique courante : A = /a/, I = /i/, O = /o/, etc. On remarquera également l’étayage qui consiste à faire correspondre dans l’écriture du mot, la syllabe orale à la syllabe écrite, sans chercher à décomposer l’une ou l’autre.1
S'inspirant de la méthode naturelle de lecture de Célestin Freinet, cette méthode prétend apprendre à lire sans apprendre à déchiffrer complètement, en se fondant sur l'apprentissage de l'écriture. Il s'agit, selon Rémi Brissiaud d'« apprendre à écrire pour de vrai, sans faire sonner les lettres, du moins dans un premier temps »2.Ainsi, il s'oppose explicitement à la pratique de la préparation de l'apprentissage de la lecture en maternelle par des exercices de discrimination phonologique (tels qu'on les trouve depuis des années dans le très répandu manuel Phono). Ce faisant, elle renoue partiellement avec la tradition scolaire des méthodes d'écriture-lecture qui avaient pignon sur rue dans l'école de la IIIe République3, sans pourtant en avoir conscience.
Disons tout de suite que le passage par l'écriture est un moyen très efficace de l'apprentissage de la lecture. En cela, la théorie d'Ouzoulias et Brissiaud est supérieure à celle du départ phonologique, majoritaire aujourd'hui dans les maternelles. La méthode correspondante a des chances d'obtenir de bons résultats. Mais on ne laisse pas de s'étonner de ce refus de faire « sonner » les consonnes, et de l'argument qui le justifie
D'où vient donc la théorie contre-intuitive de l'inaudibilité des consonnes ?
En France, c'est José Morais qui importe en 1994 des résultats obtenus en 1967 par A.M. Libermann et son équipe4. Dans L'Art de lire5, il affirme :
Lorsque nous, individus lettrés, écoutons de la parole, nous avons l'impression d'entendre une suite de sons élémentaires, appelés phones ou segments phonétiques. Dans le mot "camembert", par exemple, nous avons l'impression d'entendre d'abord [k], puis [a], puis [m], etc., et nous nous disons que le locuteur les a prononcés dans le même ordre. Pourtant, c'est faux. Le travail pionnier de Alvin Liberman et de ses collègues des Laboratoires Haskins, dans les années soixante du XXe siècle, l'a démontré très clairement. Prenons des sons de parole artificielle, synthétisée, qui sont perçus par les auditeurs comme étant les syllabes [di] et [du] [voir figure 1.15]. Si l'on ne fait écouter que les parties stables des formants, on a l'impression d'entendre respectivement [i] et [u].
Figure 1.15 — Sonagrammes de patrons acoustiques suffisants pour la synthèse de [di] et de [du].
Maintenant, supprimons cette partie stable et écoutons seulement les parties montantes et descendantes des formants, qu'on appelle des transitions de formant. On espère entendre [[d] dans les deux cas, et pourtant tout ce qu'on entend est une espèce de grésillement.
On pouvait se douter que quelque chose d'étrange se produirait, puisqu'on a l'impression d'entendre le même [d] dans [di] et dans [du], et pourtant la forme physique du son au début présente une grande différence : la transition du deuxième formant est montante dans le cas du [di], mais descendante dans le cas du [du]. Comment, avec des sons si différents, aurait-on pu entendre le même phone [l'unité perceptive la plus petite] ? On pourrait se dire : on a trop coupé, laissons un peu de la partie stable pour essayer d'entendre le [d]. Cependant, si l'on écoute les transitions avec un peu de la partie stable, on n'obtient pas plus de succès. On entend bien le [d], mais dans chaque cas avec quelque chose de plus, c'est-à-dire on entend toujours [di] et [du], les voyelles paraissant maintenant beaucoup plus brèves. Comme on est patient, on essaie encore une fois en gardant un peu moins de partie stable. Peine perdue ! On a beau aller vers la droite, aller vers la gauche, on n'entend jamais ce qu'on espérait entendre, un beau (même un vilain) [d], rien d'autre qu'un [d]. C'est comme si le [d] n'existait pas ! On ne peut pas prononcer un [d] isolément. Nos efforts pour le produire sans y ajouter une voyelle sont inexorablement voués à l'échec. Lorsque nous essayons de prononcer la valeur phonémique de la lettre "d", ce que nous prononçons est une syllabe ([de]), dans laquelle la voyelle contient peu d'énergie acoustique.
L'apport de ces expériences sonographiques est d'avoir montré que la syllabe est l'unité sonore de base dans l'émission de la parole, consonne et syllabe étant émise en une seule fois, l'une influençant la prononciation de l'autre. La graphie analytique de l'alphabet latin est donc une convention parmi d'autres possibles, consistant en l'occurrence à faire se succéder, à égalité, deux lettres qui séparent ce qui est uni dans la syllabe parlée.
Mais la conclusion de Morais, selon laquelle « on ne peut pas prononcer un [d] isolément », est reprise et généralisée par Rémi Brissiaud : « L’adulte lettré, l’enfant chez qui ''la mayonnaise de la lecture est en train de prendre'', lorsqu’ils croient entendre sonner les consonnes occlusives isolément, sont les victimes (heureuses) d’une sorte d’illusion : c’est parce qu’ils ont conceptualisé (compris) les phonèmes correspondants que cette illusion fonctionne. »6
Pourtant, José Morais ne dit pas qu'on n'entend pas les consonnes. Le fait est que la consonne [d], comme les autres consonnes occlusives sonores, [b] et [g], ne peut pas être prononcée sans une voyelle subséquente.
En revanche, les consonnes constrictives sourdes ([f], [s], [ch]) peuvent être dites seules. Si l'on imite le souffle du vent, le sifflement du serpent ou le chuintement du robinet d'eau qui coule, on prononce le son de consonne présent dans des syllabes comme [fa], [so] ou [chu]. Il est très facile de faire sonner ces consonnes sans les faire suivre d'une voyelle, ni même un [e] très court, c'est-à-dire en gardant serrés les organes producteurs de la constriction qui les caractérise.
Les constrictives sonores correspondantes ([v], [z], [j]) fonctionnent de même, à la différence qu'elles font appel à une vibration des cordes vocales.
D'ailleurs, il suffit de regarder le sonogramme du mot « chimpanzé », repris par Morais aux études de Libermann et son équipe, pour constater la trace évidente des sons [ch] et [z].
Figure 1.14 – Sonagrammes des mots « chimpanzé » (à gauche) et « camembert » (à droite).
Morais commente : « Par ailleurs, le sonagramme montre aussi des bruits, des sons non périodiques, tels que le bruit du prévoisement qui précède la consonne [b] de " camembert " (de 330 à 440 msec), et le bruit (provoqué par le resserrement du conduit vocal) de la friction correspondant aux consonnes [s] et [z], de " chimpanzé ". » Or, qu'est-ce que le son du [s] et du [z] sinon un son de friction ?
Ainsi, six sons de consonnes peuvent être prononcés seuls, contrairement à ce qu'affirme M. Brissiaud. Mais on peut aller plus loin. Aussi visible sur les diagrammes retranscrits par Morais, le « prévoisement » du [b] se retrouve dans la prononciation des consonnes [m] (version nasale du [b]), [n] et [l]. Cette fois, c'est la première partie du son émis qui est audible, avant l'ouverture de la bouche et l'émission de la syllabe. On l'entend certes assez peu lorsqu'on parle, mais elle est familière des élèves à travers l'onomatopée expriment le contentement « Hmmmmm! » (dans lequel on n'est pas obligé de prononcer la deuxième partie du son, pourtant notée par les multiples « m »).
Plus encore, ce ne sont pas toutes les occlusives qui ne peuvent pas se prononcer seules. Les occlusives sourdes ([t], [p], [k]), non accompagnée par la vibration des cordes vocales cette fois, peuvent être prononcée de manière très brève et percussive : l'ouverture de la bouche n'aboutit pas à un l'émission d'un son de voyelle spécifique. On peut réduire l'effort articulatoire des lèvres au minimum et ainsi diminuer l'influence de la voyelle sur l'articulation de la consonne.
Le [e] bref, sans arrondissement des lèvres, sans vibration des cordes vocales, n'est pas une voyelle mais une sorte d'anti-voyelle, une simple position de repos de la bouche qui permet de prononcer les occlusives sourdes sans avoir à choisir une voyelle spécifique pour les accompagner.
Il s'agit de la manière de prononcer les consonnes qu'on retrouve dans l'onomatopée « Tttt, tttt... » signifiant la négation, en position finale des mots comme « mat », « mec », « cap », etc.
Il n'est donc pas obligatoire de dire [té], ni même [te], quand on veut prononcer ce type de consonne. M. Brissiaud rejette cette possibilité en affirmant que la prononciation de la consonne seule aboutirait, dans le cadre de la fusion avec une voyelle subséquente, des syllabes erronées du type [bea] (au lieu du [ba] attendu).7
Il semble que la prononciation percussive des occlusives sourdes évite ce genre d'écueil, en n'instaurant pas d'amalgame, chez l'élève, entre la consonne et une voyelle qui lui serait associée a priori. Le [e] bref non arrondi serait le signe d'une incomplétude, le moyen de montrer que la consonne est en attente d'une voyelle pour pouvoir réaliser sa vocation de syllabe.
On comprend alors pourquoi, lors des sonogrammes, la recherche de la consonne « pure », par troncation du son de voyelle, n'aboutit qu'à un grésillement indistinct. C'est que la consonne occlusive a besoin d'une émission d'air, après l'occlusion qui les caractérise. Cette émission fait partie intégrante du son de consonne.
Faisons le point :
– les syllabes se prononcent d'une traite, la consonne étant modifiée par la voyelle qui la suit, puisque la bouche forme la seconde avant même de prononcer la première ;
– la majorité des consonnes peuvent se prononcer seules, tout ou partie.
On objectera que ces consonnes prononcées seules ou presque sont très différentes des consonnes prononcées en compagnie d'une voyelle. José Morais parle de « sons si différents » à propos de la consonne [d] dans les syllabes [di] et [du]. De même, on critiquera les tentatives des instituteurs qui font sonner plus longtemps les consonnes constrictives pour les faire entendre ([rrrrr], [vvvv], etc.), en affirmant que ces sons ne sont pas identiques au [r] initial du mot « rateau » ni au [v] de « voiture ».
Il me semble que cette objection va trop loin. Quoi qu'il arrive, la consonne occlusive sonore labio-dentale [d] reste labio-dentale, sonore et occlusive. Si l'on peut comprendre qu'un enfant puisse confondre un [d] et un [t], ou ne pas entendre exactement la même chose quand il entend [di] et [du], lui qui est encore en train d'apprendre la prononciation correcte des mots français, il ne semble pas pour autant que la difficulté soit insurmontable.
Quand on fait prononcer à l'enfant le son d'une voiture qui roule à vive allure (« Vvvvv ! »), il peut ne pas reconnaître immédiatement le [v] bref de « voiture ». Mais les deux sons se prononçant presque à l'identique, et mobilisant les mêmes organes phonateurs, ont une parenté motrice qui doit pouvoir à terme rendre évidente leur similitude. Il n'y a donc pas plus de raison de s'interdire de faire prononcer [v], [m] ou [t] aux élèves que de leur faire prononcer des voyelles.
EDIT à la suite des commentaires judicieux d'abcdefgh :
[On voit donc que certains chercheurs maximalisent la différences entre le son et l'articulation des consonnes, nient la possibilité réelle de prononcer à part consonnes et voyelles, tout cela pour justifier un refus d'une phase de synthèse à partir des phonèmes dans l'apprentissage de la lecture.
Ils semblent considérer que l'écriture alphabétique est un code arbitraire, sans lien avec la parole orale, et qui ne peut être expliqué aux élèves. Or, cette écriture n'est pas arbitraire :
> les consonnes ont une existence autonome en tant que sons préexistant à leur utilisation avec les voyelles,
> l'ordre d'écriture des consonnes et des voyelles correspond à leur succession au moment de l'émission de la syllabe.
En cela, la co-articulation et la modification réciproque des consonnes et des voyelles sont seulement deux des nombreuses caractéristiques de la prononciation des syllabes. Au lieu de voir dans l'écriture alphabétique un code déficient, mieux vaut y voir un outil de simplification qui retient tout de même deux caractéristiques importantes de la syllabe orale comme principe structurant de codification.
On aurait donc tort de considérer cette écriture comme un code arbitraire et susceptible de prêter à confusion. Ce n'est pas non plus parce que d'autres codes possibles existent que celui-ci est purement conventionnel.
L'analyse préalable ou subséquente à son articulation de la syllabe est donc possible. Elle me semble même nécessaire, si l'on considère que l'écriture alphabétique distingue justement consonnes et voyelles, et cela dans un ordre non arbitraire. On prononce certes voyelles et consonnes dans un seul mouvement, mais la consonne est tout de même prononcée avant ou après la voyelle qui forme le centre de la syllabe : l'écriture rend compte de cet ordre.
Si on ne le fait pas, pourquoi l'élève ne déciderait-il pas d'écrire la consonne et la voyelle dans l'ordre qu'il veut ? Dans la méthode imaginée par M. Ouzoulias, l'élève doit faire confiance à l'instituteur et accepter sans barguigner que [ma] s'écrit "ma" et non "am". En s'interdisant de décomposer la syllabe et de faire prononcer à part consonnes et voyelles, on ne fait pas appel à l'intelligence des élèves et l'enseignement se fait, au moins pendant le temps de l'imprégnation, dogmatique.
Et qu'est-ce qui garantit que l'élève qui ait appris sans réfléchir que [ma] s'écrit "ma" puisse ensuite savoir écrire seul [na], par exemple. Dans l'absolu, il faudrait d'abord avoir écrit une fois une syllabe pour pouvoir la lire. Du paradoxe d'une méthode s'inspirant de Freinet et rendant possible, en théorie, le retour à la pire des méthodes syllabiques d'avant l'école de Jules Ferry !
Cependant, rassurons-nous, ce parcours de toutes les syllabes ne sera pas utile parce que les élèves parviendront d'eux-mêmes, à force d'écrire, à comprendre le double principe de la distinction des consonnes et des voyelles, et du respect de l'ordre oral de leur émission au moment de l'écriture de la syllabe. On peut cependant imaginer que certains puisse être un peu perdus et mettre un peu plus de temps pour le comprendre.
Dès lors, pourquoi ne pas enseigner ces deux principes explicitement, puisque cet enseignement, comme j'ai essayé de le montrer, est possible !]
L'enseignant peut s'appuyer pour se faire sur tous les outils qui permettent d'aider à se souvenir de la manière de le faire : les sons de la vie quotidienne, les autres lettres, plus faciles à analyser, qui constituent les bases d'une progression du plus simple au plus difficiles, les gestes phonomimiques de Borel-Maisonny, les figurines des Alphas, et tout simplement les lettres. Commencer par l'écriture est de très bonne pratique, mais ne peut pas s'opposer à l'analyse sonore, en tout cas sous le prétexte que les consonnes ne s'entendraient pas.
La méthode de MM. Ouzoulias et Brissiaud est tout à fait acceptable, et tranche avec l'écueil qu'a constitué le développement des exercices phonologiques sans lien avec l'écriture. Mais il n'est pas nécessaire de verser dans l'excès inverse.
Il semble surtout que l'argument erroné de l'inaudibilité des consonnes doive être combattu en prévision d'utilisations plus pernicieuses, par exemple pour justifier l'absence complète de déchiffrage, dans le cadre de méthode globales non analytique.
1http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/04/07042014Article635324487489828633.aspx
2Ibid.
3Guy Morel, « Apprentissage de la lecture : les dégâts du révisionnisme ». URL : http://michel.delord.free.fr/morel-ulm.pdf
4A.M. Liberman, F.S. Cooper, D. Shankweiler et M. Studdert-Kennedy, «Perception of the Speech Code», Psychological Review, 1967, n°24, pp. 431-461
5José Morais, L’art de lire, Paris, Odile Jacob, 1994, pp. 85 à 90.
6http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/04/04042014Article635321946980819517.aspx
7Ibid.
 11 commentaires
11 commentaires Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires



